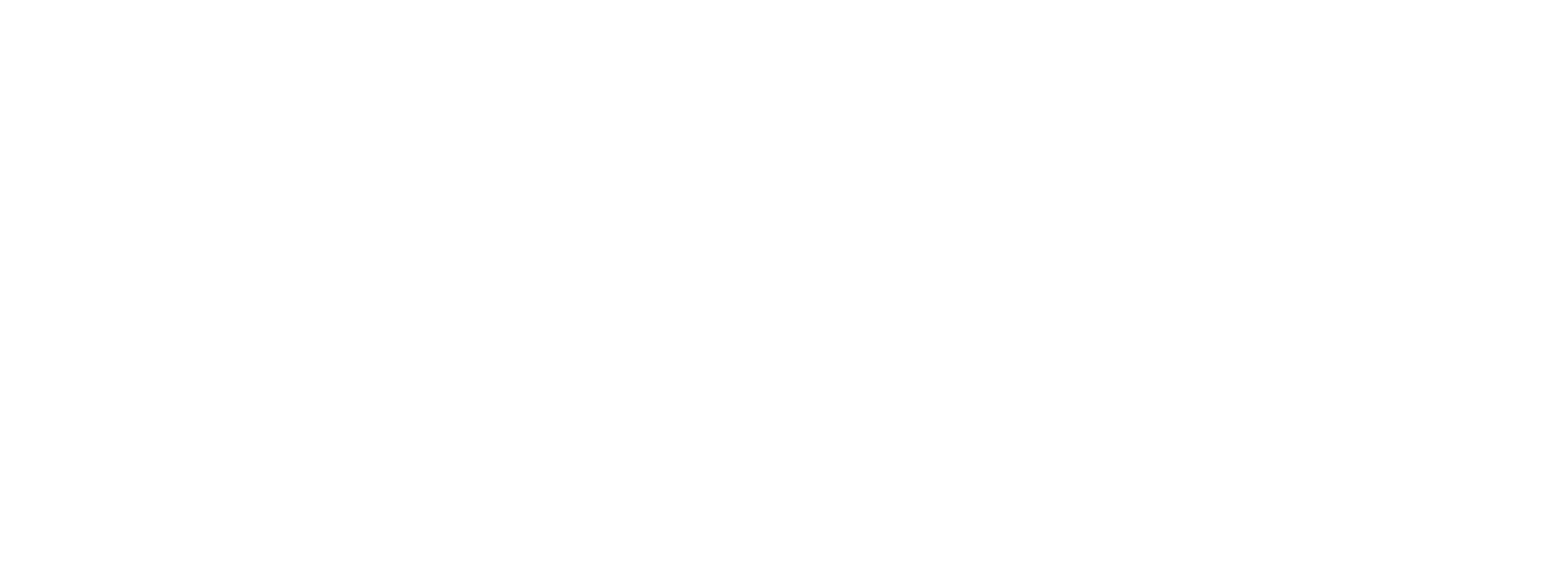« Docteur Jérôme » et « Mister Aucan » : bien connu des Pacific Islanders pour son implication dans la recherche océanique depuis Hawaï et la Nouvelle-Calédonie, Jérôme Aucan, directeur du programme PCCOS de la Communauté du Pacifique s’est confié sur son parcours professionnel, sa vision de la recherche, l’impact des technologies ou encore son rôle de sensibilisateur auprès des publics. Retour sur des échanges nourris avec un Docteur passionné aux lunettes de soleil vissées sur le crâne.
__
Bonjour Jérôme et bienvenu sur NeoTech ! Pour débuter notre échange, peux-tu te présenter à nos lecteurs et leur partager ton parcours professionnel ?
Salut NeoTech, moi c’est Jérôme Aucan, parfois appelé « Docteur Jérôme » dans le reste du Pacifique. Je suis responsable du Centre des Sciences Océaniques à la CPS, la Communauté du Pacifique. À la base, je suis chargé de recherche à l’IRD, actuellement en détachement à ce poste à la CPS.
Côté études, j’ai obtenu un doctorat – d’où « Docteur Jérôme » – en physique des océans de l’Université d’Hawaï et j’ai aussi un diplôme d’ingénieur en mécanique des fluides de l’ENSTA, l’École Nationale Supérieure des Techniques Avancées ; je suis également titulaire d’un double diplôme de l’Université James Cook, à Townsville, en Australie.

__
Ok, solide le Monsieur ! Et tu es donc actuellement directeur d’un… acronyme : PCCOS. Que signifie cet acronyme et en quoi consiste ton job au quotidien ?
La Communauté du Pacifique est une organisation intergouvernementale régionale à l’échelle du Pacifique ; on a vingt-sept membres qui représentent les vingt-deux pays et territoires de la région, ce qui inclut tous les petits états insulaires indépendants, mais aussi les territoires de plus grands pays.
On dénombre donc les trois territoires français, mais aussi les Samoas américaines, Tokelau, les Îles Cook, etc, mais aussi cinq états qu’on appelle « métropolitains » : des pays plus développés que sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, les États-Unis, et depuis quelques temps le Royaume-Uni qui a fait son retour parmi les membres de la CPS.

__
Bien compris… Et PCCOS dans tout ça alors ?
Le « PCCOS » a été imaginé en 2017 avec l’ambition de mieux coordonner les sciences océaniques au sein de la CPS ; il faut comprendre que la CPS est structurée et travaille en « divisions » : un peu moins de la moitié des agents sont domiciliés à Nouméa et l’autre moitié à Fidji.

Toutes les divisions incluent des disciplines très variées, telles que la santé publique, l’agriculture, mais également des domaines océaniques : les pêcheries, qu’elles soient océaniques ou côtières, sont surtout basées à Nouméa et une autre division orientée « géosciences », est, elle, basée à Fidji et travaille sur divers sujets : les vagues, les phénomènes extrêmes, les cyclones etc.
Au départ, l’idée de notre programme, c’était :
- De mieux coordonner le travail entre ces divisions,
- De mieux coordonner le travail de la CPS avec les partenaires dans la région,
- D’assister directement les pays à travers du « renforcement de capacités ».
En effet, d’autres grandes organisations australiennes, françaises, néo-zélandaises ou américaines collaborent également autour de ces sujets importants pour la région mais, parfois, les liens entre elles sont distendus, ou inexistants. A travers le PCCOS, la CPS joue donc un rôle centralisateur pour optimiser la coordination entre les instituts de la région.
Au sujet du « capacity building », notre rôle est de s’entourer d’un réseau de jeunes professionnels de l’océan à qui on donne des moyens, parfois des financements, pour qu’ils puissent effectuer des stages dans les pays concernés, assister à des conférences scientifiques et à divers événements thématiques régionaux ou internationaux pour vulgariser la science océanique et s’assurer que les pays du Pacifique soient bien représentés sur la scène internationale, que ce soit lors d’événements tels que la « COP climat » ou lors de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, par exemple…
__
Vous avez récemment travaillé sur l’installation d’un houlographe novateur sur un DCP de la Province Sud ; peux-tu nous expliquer le caractère novateur de ce projet ?
Ce qui est novateur dans ce projet, c’est qu’on a couplé deux systèmes qui ne sont absolument pas novateurs ! Les DCP – « Dispositif de Concentration de Poissons » – ça existe depuis longtemps ; quand il y a des trucs qui flottent à la surface, les poissons aiment bien et ça les attire : en gros les DCP agrègent tout un écosystème, des petites algues jusqu’au thon.
Ces systèmes sont très pratiques parce qu’ils permettent de fixer les thons à proximité des îles et, même s’ils restent situés en eau profonde, les DCP sont atteignables avec de petites embarcations. Alors lorsque le thon est au RDV, c’est une formidable nourriture pélagique pour les populations insulaire et côtières ! Il existe différents types de DCP mais on arrive généralement à les déployer dans de l’eau avec succès jusqu’à deux-trois mille mètres de profondeur. Bref, ce système existe, fonctionne, est éprouvé.
Ensuite, un autre système : les houlographes, capables de mesurer la houle et donc d’obtenir des données précises sur l’état de l’océan. Ces technologies ont beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies. D’ailleurs, l’un de mes premiers jobs, en 1999, à Hawaï, consistait justement au déploiement de houlographes avec des contraintes sur la taille du mouillage, sur la taille de la bouée, et avec parfois, non pas des accidents, mais des ruptures de mouillage.
Le caractère novateur de ces DCP intelligents, c’est que nous avons réussi à coupler ces deux systèmes en rattachant un petit houlographe – qui ne pourrait pas être ancré tout seul à ces profondeurs – à un DCP qui, lui, dispose déjà d’un mouillage éprouvé. Ça nous permet de déployer des houlographes de petite taille à des profondeurs qu’on n’aurait jamais pu atteindre si on ne voulait mouiller que l’houlographe. Ça permet également aux propriétaires des DCP de savoir si leur DCP a lâché ou pas : grâce aux données que renvoient la bouée par satellite, on connait sa position géographique ce qui nous permet de savoir rapidement si le système est à la dérive ou toujours à sa place.
Autre aspect novateur également, ça fait travailler des gens qui, auparavant, ne travaillaient pas forcément ensemble ; par exemple, des scientifiques collaborent avec des communautés de pêcheurs… Autre exemple, dans des petits pays, le ministère des pêches travaille avec les services météorologiques.
__
Captivant… Les politiques d’« open data » se multiplient en Nouvelle-Calédonie ; à ce sujet, la CPS a mis en ligne le « Pacific Data Hub » : à quoi sert ce portail ? Quel est le lien de ton département avec cet outil ?
Pour résumer, ce portail est une initiative régionale de la CPS qui permet d’archiver, d’organiser, de redistribuer les différentes données de la région, que ce soit celles contenus dans les publications, les livres au format numérique, des cartes et cartographies ou des produits d’informations géospatiales etc…
Le PCCOS, en tant que centre sur les sciences océaniques, génère des données – des données de modèles, des données d’observation – comme celles des bouées houlographes par exemple. A ce titre, on travaille étroitement avec le « Pacific Data Hub » pour rendre ces données accessibles à tous, ce qui est le plus important. C’est bien d’avoir des données mais, ensuite, il faut que les gens puissent les réutiliser donc, il faut qu’elles soient accessibles facilement et gratuitement, aux standards internationaux pour être compatibles avec d’autres systèmes. Il faut aussi qu’elles soient aussi « validées », « justifiées ».
Pour résumer, les professionnels envoient leurs données sur le « Pacific Data Hub » et elles sont instantanément accessibles à tous les pays du monde avec toutes les métadonnées, explications etc…

__
Parlons un peu de câbles sous-marins… Il nous semble que tu travailles sur un projet de câble intelligent. Peux-tu nous en dire plus ?
Les câbles intelligents, c’est une initiative qui date à peu près de 2011-2012. Des câbles, on en met sous l’eau depuis 150 ans ! Les premiers, c’étaient des câbles en cuivre, avec du goudron autour. Le premier, c’était entre la France et l’Angleterre. Je crois qu’il avait duré un quart d’heure avant d’être sectionné… Aujourd’hui, la technologie s’est bien améliorée.
Tout le monde parle de « fibre optique » : ces câbles sont devenus absolument indispensables. Si tu regardes le trafic mondial d’internet, 90-95% passent par ces câbles posés au fond de la mer. C’est de la fibre optique posée en fond de mer. Mais, attention, le niveau moyen des fonds, c’est 4000 mètres !

Malheureusement, historiquement, ces câbles ne relèvent aucune donnée. D’un côté, on a des scientifiques qui se lamentent du peu de données dont ils disposent sur les fonds océaniques – complexité, profondeur, pression, contraintes géospatiales, coûts exorbitants… et de l’autre nous avons ces câbles technologiquement avancés.
La collecte de données en océan, ça peut donc être un peu ingrat… alors, en 2011, un chercheur a lancé une idée : « Pourquoi on n’essayerait pas d’allier les câbles de télécommunication et la collecte de données ? ». C’est ainsi qu’est née l’initiative « Joint Task Force » sur les câbles intelligents. « Smart Cable », c’est un acronyme : « Smart » pour « Science Monitoring and Reliable Telecommunication ».
__
Ok pour la théorie mais, en pratique, les câbles appartiennent à des groupes privés qui n’aiment pas trop qu’on touche à leurs jouets… Alors comment on règle ce problème ?
Effectivement, c’est compliqué ! Mais ça mérite quelques explications ; les câbles qui traversent les océans, c’est de la fibre optique. Le concept de la fibre, c’est d’envoyer des messages lumineux qui voyagent dans des « tuyaux ». Pourtant, au bout d’un moment, le signal optique subit une atténuation. Il faut alors le réamplifier en installant un répéteur à intervalles réguliers, tous les 100 à 200 km. Donc, lorsqu’on dit que c’est un « câble de fibre optique », c’est aussi un conducteur électrique – on parle de 30 à 50 000 volts de chaque côté du câble ! – qui permet d’envoyer de l’électricité à travers le câble pour alimenter des répéteurs installés à intervalles réguliers qui vont, eux, réamplifier le signal optique et le renvoyer pour les prochains 200 km. Vous me suivez ?

Maintenant, pour traverser 6000 km, ça en fait déjà un paquet de répéteurs optiques ! Fort de ce constat, l’idée c’est d’utiliser l’électricité, la fibre et les répéteurs en y ajoutant quelques capteurs pour récolter de précieuses données. Dit comme ça, ça paraît très simple… Le problème, c’est que les câbles de télécommunication, ce sont des petits bijoux de technologie avec une grosse contrainte de propriété industrielle : les industriels du câble ne voient pas d’un bon œil nos amis scientifiques débarquer avec leurs gadgets : « qu’est-ce qu’ils vont aller bricoler dans mon répéteur ? ». Logique… A mon sens, il faut que ce soient les constructeurs qui prennent en charge ce système, ce qui commence d’ailleurs à être le cas.
D’autre part, il existe également un problème juridique parce que les câbles de télécommunication sont protégés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces câbles de télécommunication bénéficient ainsi d’une très forte protection juridique, ce que les systèmes de mesures scientifiques n’ont pas. Au début de l’initiative, les opérateurs et fabricants de câbles ne voulaient pas entendre parler de « notre truc » parce qu’ils se sont dit que ça allait nous faire perdre leur protection juridique si on rajoutait des capteurs scientifiques dessus. On a avancé sur ces questions en parallèle, puis sur les capteurs, sur le contexte, sur le financement, etc. Tant et si bien qu’aujourd’hui, en ce moment même, c’est la compétition pour savoir qui du Portugal, du Vanuatu ou de la Nouvelle-Calédonie va être le premier site du premier câble intelligent au monde. Suspens…
__
Prenons un peu de hauteur maintenant… Quels sont les principaux enjeux auxquels la recherche et l’innovation liées aux océans sont confrontés actuellement ?
Alors, je vais essayer de faire simple… L’océan a de nombreuses propriétés que nous devons apprendre à mesurer pour mieux comprendre son fonctionnement et ce qu’il s’y passe. Parmi les propriétés de l’océan, il y a, par exemple, la température. Pour la mesure, tu poses un thermomètre numérique, un enregistreur, des piles et c’est bon, tu disposes d’un capteur efficace. Facile !
Pour la salinité, ça devient un petit peu plus compliqué. Le capteur doit mesurer la conductivité d’une petite parcelle d’eau. Sachant que si tu le laisses un peu trop longtemps, il y a du biofouling dessus, des algues qui poussent, ce qui affecte ta mesure et dont il faut tenir compte… Du coup, il faut inventer des systèmes qui empêchent qu’il y ait trop d’algues qui poussent. Un peu moins facile déjà !
Ensuite, parlons un peu des mesures de quantité d’oxygène dans l’océan ; pour ce faire, on a plusieurs systèmes mais c’est un domaine où il faudrait encore innover pour répondre aux contraintes. Et puis, on peut parler aussi de la teneur en métaux… Une petite startup, AEL, a breveté un super système de mesure des traces de métaux, même les quantités infinitésimales. C’est un excellent exemple d’innovation utile à la recherche…
Un peu plus complexe encore, on a besoin de connaître les différentes espèces de phytoplanctons dans l’eau, au moment « T ». A l’époque, et c’est encore le cas aujourd’hui, on relevait un échantillon d’eau de mer, on la filtrait et on examinait au microscope les éléments biologiques grâce à nos expertises scientifiques. Et puis, « l’ADN environnemental » est arrivé : encore une innovation qui a révolutionné nos recherches en nous permettant de savoir, en quelques instants, ce qui se trouve dans l’eau et d’identifier les espèces présentes et ce, de manière autonome. Une révolution !
__
L’une des problématiques du territoire, c’est que la « recherche », recherche, mais que son prolongement dans des applications et actions concrètes est souvent rare ce qui est une forme de manque à gagner pour l’économie calédonienne. Quel est ton point de vue sur ce sujet ? Penses-tu qu’il existe des solutions pour lier la recherche à l’économie ?
Mon point de vue est assez simple ; nous sommes des scientifiques qui « observons, mesurons et suivons » l’environnement. Notre travail bénéficie à la société dans son ensemble et nous n’avons pas forcément de but lucratif évident.
Mesurer l’état de santé de nos océans pour approfondir nos connaissances et mieux le protéger, c’est une question sociétale globale, qui concerne tout le monde. Cela étant, nous travaillons avec du matériel : la mise au point de capteurs, par exemple, peut-être développée par le privé et générer des bénéfices.
Ma vision globale, c’est finalement : chacun à son rôle et celui de la recherche est justement… de rechercher, sans arrière-pensée lucrative !

__
On te voit régulièrement intervenir dans les médias locaux pour « expertiser » l’actualité des catastrophes naturelles : alerte tsunami, tremblement de terre etc… Tu envisages une reconversion en M. Météo ?
Non, mais c’est une partie du boulot qui me plaît. Une partie de mon métier, c’est de vulgariser l’information scientifique pour la rendre accessible au grand public. Les réseaux sociaux ne sont pas des canaux d’information fiables aujourd’hui donc, le chercheur, à mon sens, c’est également un éducateur, un formateur.
Pour ma part, je prends donc beaucoup de plaisir à expliquer aux journalistes et au grand public ce qui nous entoure avec des mots simples pour que les gens retiennent les informations et en apprennent plus sur l’océan. C’est ça qui me motive ! Et, dans ce contexte, quand les journalistes viennent me chercher pour faire une interview à la télévision, je réponds présent… tout autant que lorsque les services du gouvernement me demandent d’intervenir dans des groupes d’experts sur des sujets complexes, comme lors de l’approche des cyclones, par exemple.
__
Question « philo » mais ô combien d’actualité : est-ce que tu penses que l’innovation technologique peut sauver les océans ?
Je pense qu’elle peut permettre de faire prendre conscience aux gens de certaines urgences ; tu sais, je crois toujours aux vertus d’un bon documentaire naturaliste ! Je vois les effets sur mon fils de six ans, par exemple. C’est capital que les publics voient, découvrent et tombent amoureux de la nature et qu’ils prennent conscience des menaces qui pèsent sur elle…
Quand tu vis en région parisienne, tu ne comprends pas forcément pourquoi le changement climatique va occasionner l’émigration de centaines de milliers d’êtres humains sur Terre ! Le changement climatique, les vagues de chaleur marine, l’acidification des océans, la surpêche etc. sont autant de menaces dont on commence à peine à connaître les impacts !
Dans ce contexte de crise écologique, l’innovation technologique va donc servir à mieux mesurer, et donc mieux comprendre et donc… mieux agir : on parle là de prendre des « décisions éclairées ».

__
Une dernière information ou actualité pour nos lecteurs ?
Oui, pour poursuivre sur ce sujet ; comme je t’expliquais, l’océan est un milieu hostile. Les moyens qu’on a mis au point pour aller le mesurer il y a quarante ans, ceux dont on sait qu’ils fonctionnent, continuons à les utiliser pour plusieurs raisons ;
Quand tu vas poser un instrument fragile au fond de la mer, avec un navire de 50 mètres qui coûte 40 000 euros la journée, qui a 15 jours de mer pour aller sur site et 15 jours de mer pour rentrer, tu veux que ton système… fonctionne ! C’est parfois pour cette raison qu’on peut paraître frileux vis-à-vis de l’innovation. On doit d’abord être certain que la technologie fonctionne vraiment…
Qui plus est, quand tu vas collecter des données avec un système novateur, il faut s’assurer, en amont, de la compatibilité de la donnée. Même si tu es censé mesurer le même paramètre, si la nouvelle donnée n’est pas compatible avec l’ancienne, tu fous en l’air tes quarante dernières années de travail. Les chercheurs s’appuient sur des séries temporelles longues qui sont de véritables mines d’or et de découvertes et, si on n’y prend pas garde, en testant une innovation, on peut casser ces séries pourtant capitales pour comprendre le climat et les millions de facteurs qui le constituent.
Du coup, innover, d’accord ! Mais en tenant compte des risques parce que les budgets de recherche sont restreints : on manque de navires et même s’il existe plein de solutions technologiques pertinentes, rien ne remplace le bon vieux navire océanographique des années soixante ; pourtant, ils partent à la casse les uns après les autres sans être remplacés… A mon sens, on devrait toujours pouvoir cumuler les systèmes dont on sait qu’ils fonctionnent ET les systèmes innovants pour que la « passation technologique » soit prudente et permettent de sécuriser les données.

__