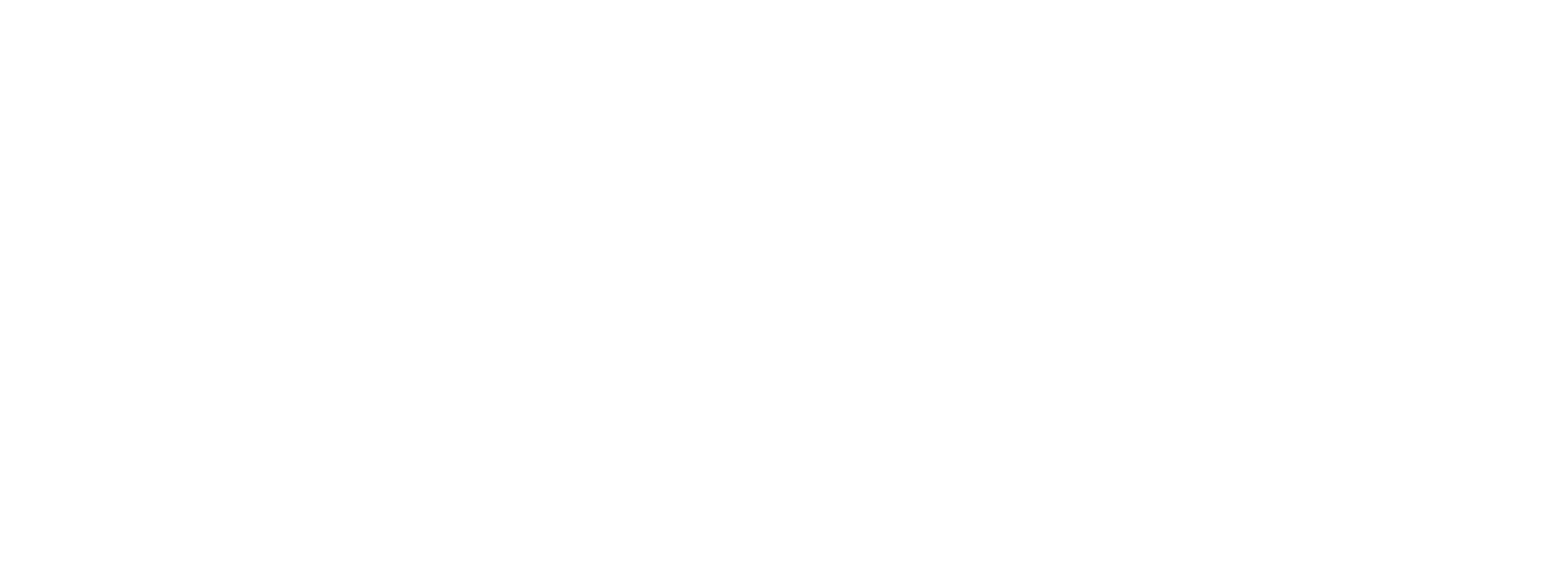Dans un monde hyperconnecté, le numérique est devenu un allié incontournable. Et ce n’est pas la rédac’ de NeoTech qui vous dira le contraire. Grâce à internet, chacun (ou presque) peut explorer la planète depuis son canapé, sans décalage horaire, ni billet d’avion. Pourtant, derrière cette promesse d’ouverture et de découvertes infinies, le revers de la médaille n’est jamais très loin.
Paradoxalement, la démocratisation du web saupoudrée d’un zeste d’ultra-mondialisation et d’une pointe de libéralisme tend malheureusement à une certaine forme d’uniformisation et ce, dans de nombreux domaines. Et la linguistique ne fait pas exception. Si la langue de Shakespeare s’impose comme un passe-partout international, bien pratique, elle entraîne dans son sillage la disparition progressive des langues locales, tribales et autochtones et, par extension, une partie des cultures associées.
Mais si la technologie, au lieu d’être un fossoyeur, devenait un tremplin pour redonner à ces langues en péril leurs lettres de noblesse ? Car oui, n’en déplaise à certains, le numérique peut aussi être un formidable outil pour cultiver la diversité.
__
Une aiguille dans une botte de foin
On ne va pas se mentir, le numérique est loin d’avoir la meilleure place dans la préservation des langues autochtones. Pourtant, il offre des outils redoutablement efficaces pour les documenter, les valoriser et les transmettre. En 2014, Frederico Andrade, Daniel Bogre Udell et Lindie Botes ont fondé Wikitongues, une plateforme qui s’est donnée pour objectif de collecter et de documenter l’intégralité des langues du monde – oui, rien que ça ! Sur cet outil, chacun peut envoyer ou rechercher une vidéo ou une ressource sur une langue parlée quelque part sur notre belle planète bleue. Autre initiative, FirstVoices, développée en 2003 par le First Peoples’ Cultural Council. Ce projet met à disposition des ressources pour découvrir, apprendre et promouvoir les langues autochtones en valorisant leurs histoires et leurs cultures.


Mais tout n’est pas rose. Aujourd’hui, moins d’une centaine d’entre elles sont réellement présentes sur le web, rendant leur accès et leur visibilité très limités, notamment pour les jeunes générations. Et pour ne rien arranger, la fracture numérique empêche de nombreuses communautés d’accéder aux outils nécessaires à leur préservation, faute d’infrastructures adaptées ou de compétences techniques.
Conscientes de ces enjeux, des organisations internationales militent activement pour la sauvegarde de ces langues. Selon l’UNESCO, plus de la moitié des 7 000 langues parlées dans le monde pourraient disparaître d’ici la fin du siècle. En 2016, le Forum Permanent des Nations Unies sur les questions autochtones alertait déjà sur le fait que 40 % des langues mondiales étaient menacées d’extinction. Pourtant, la préservation de celles-ci constitue une véritable richesse culturelle et linguistique… Cette préoccupation ne se limite pas aux ONG. À l’échelle locale, des initiatives émergent, tentant d’apporter leur pierre à l’édifice de cette préservation.

__
Gros plan sur le Pacifique
En Nouvelle-Calédonie, le projet DIKALA, porté par Anne-Laure Dotte, maîtresse de conférences en linguistique océanienne, est l’exemple d’une initiative locale visant à préserver les langues kanaks. Lancé le 1er février 2025 à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, le projet ambitionne de développer trois outils numériques pour accélérer l’étude et la valorisation de ces dernières. Avec son équipe, elle travaille à la mise en place de « LexiKa », une base de données lexicale comparative, de « KaLiA », un atlas linguistique interactif et d' »ArKa », une archive numérique regroupant des corpus en langues kanaks. Conçus pour être participatifs, ces outils encouragent les locuteurs, en particulier les plus jeunes, à contribuer à la valorisation de leur langue et à devenir acteurs de leur patrimoine linguistique.
Du côté de la Polynésie française, la startup E-Reo s’est donnée pour mission de rendre l’apprentissage du tahitien plus accessible grâce à sa plateforme « SPEAK REO TAHITI e-learning ». Proposée sous forme d’abonnement, elle met à disposition des cours en ligne ainsi que des supports pédagogiques pour accompagner les apprenants. En parallèle, E-Reo travaille avec différentes communautés pour concevoir des applications dédiées à la préservation et à la transmission des langues et cultures autochtones. C’est notamment le cas de « Kaunalewa« , une application météo qui s’appuie sur ces outils pour préserver la langue hawaïenne et ses cultures.

Ces initiatives participent activement à la revitalisation des langues régionales en créant un pont entre héritage culturel et nouvelles technologies. Elles offrent ainsi une alternative moderne pour apprendre ou découvrir ces langues en danger. Mais si le numérique joue un rôle dans ces démarches, il ne saurait à lui seul en assurer la survie. (Mal)heureusement, la transmission reste avant tout une affaire d’engagement humain et de volonté politique.
__
Une mise en perspective…
En 2019, le Canada a adopté une loi sur les langues autochtones qui intègre un volet spécifique pour financer leur ré-appropriation et leur maintien. Cette initiative a permis de soutenir des programmes de formation linguistique, la création de ressources éducatives ainsi que le développement d’outils numériques qui facilitent leur transmission.
Au-delà du simple aspect numérique, de nombreuses autres démarches doivent venir se greffer à ce qui n’est finalement qu’un outil. La réduction de la fracture numérique, le déploiement de financements dédiés et la mise en place de formations adaptées sont autant de moyens essentiels pour outiller correctement les populations locales et leur permettre de s’approprier ces initiatives. À l’instar du Canada, la réussite de ces projets repose aussi sur la mise en place de politiques publiques, notamment en matière de culture et d’éducation, misant sur l’implication des communautés locales. Une collaboration étroite entre institutions, chercheurs, développeurs et natifs est indispensable pour inscrire ces actions dans la durée, préserver les richesses linguistiques et culturelles. Le numérique a beau être un catalyseur, il ne pourra pas être pleinement efficace sans un engagement collectif.
__
Acteur ou spectateur ?
La technologie peut réellement être un moteur puissant dans ces démarches de préservation des langues autochtones mais elle ne saurait en être l’unique solution. L’avenir de ces langues repose avant tout sur la volonté des communautés locales, des institutions et des gouvernements de s’engager dans leur transmission et leur valorisation. Au-delà des algorithmes et des bases de données, ce sont essentiellement leurs locuteurs qui leur donnent vie. Le numérique offre de formidables opportunités mais c’est avant tout à nous d’en faire un instrument de préservation(s) culturelle(s) et non un simple témoin de leurs disparitions.
__