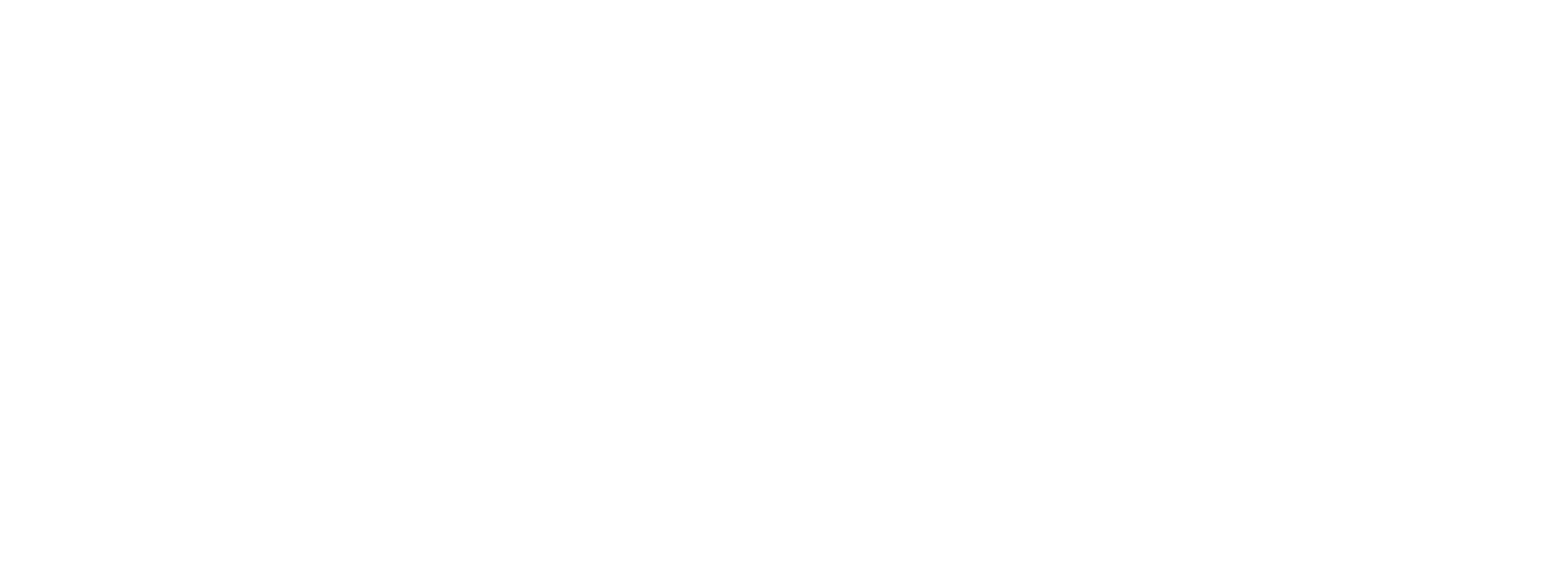La science fait sa teuf ! Quatre parcours immersifs autour de la thématique « Intelligence(s) » étaient proposés par l’IRD à l’occasion de la Fête de la Science. L’opportunité de franchir les portes de l’Institut pour découvrir le parcours intitulé « Intelligence artificielle et instrumentation ». Spoil alert : très peu d’IA mais bien plus de data. Et ça tombe bien car la data, c’est aussi notre dada !
__
Y’a pas d’IA, mais y’a l’IRD !
« Des visites guidées interactives, des rencontres avec des scientifiques passionnés et des expériences ludiques accessibles à tous les publics ». C’est ainsi qu’était présenté le programme de la Fête de la Science qui entendait bien dévoiler les « coulisses de la recherche scientifique » avec pour objectif de « mieux comprendre le monde qui nous entoure ». La proposition fait saliver alors, à 13h15, nous voici devant les portes de l’IRD pour « écouter, observer, ressentir… et entrevoir la science comme on ne l’avait jamais vue ! ». Pourtant, quelques jours auparavant « un événement exceptionnel » avait perturbé l’atelier initialement prévu sur le mouvement des requins.


Mais, pas de panique, le laboratoire IMAGO n’a pas disparu pour autant et c’est donc avec Céline Bachelier, Guillaume Detandt et Damien Vignon que nous sommes embarqués pour une quarantaine de minutes de présentations « in situ » de leurs travaux. Après quelques mots introductifs, c’est Céline, ingénieure spécialisée en instrumentation océanographique, qui prend la parole pour nous en dire plus sur les manières et outils permettant de récupérer des données fiables afin de mesurer les impacts du changement climatique. Car qui dit « instruments« , dit automatiquement « données« .
Température, salinité, courants, densité ou encore acidité sont autant de paramètres à relever pour mieux comprendre l’équation « océan + atmosphère = climat ». Et notre ingénieure de présenter ensuite les instruments nécessaires à la récupération des précieuses données. Capteurs au mouillage, capteurs sur les navires, bouées dérivantes, bouteilles de prélèvements et autres sondes de profilage n’ont bientôt plus aucun secret pour un public qui a répondu présent en nombre. Le job est clair : utiliser les technologies connectées pour collecter et étudier des paramètres physiques du milieu marin afin d’essayer de mieux comprendre et d’appréhender les impacts néfastes du changement climatique.
« On se sert des paramètres physiques pour contextualiser et caractériser l’environnement » – Céline, Bac océanographique mention « Excellent »


__
La science, au chevet de la nature
Après cette petite introduction « data-oriented« , nous voilà en compagnie de Damien Vignon, spécialiste de l’instrumentation géophysique et océanographie mais, nous demande-t-il de préciser, « certainement pas physicien, ni spécialiste de l’IA ». Néanmoins, l’homme a de la bouteille et s’embarque dans une présentation globale du réseau sismique néo-calédonien, du phénomène de subduction, puis des six stations locales, en présentant en direct deux capteurs, un accéléromètre et un sismomètre, installés sur la Grande Terre. Après avoir expliqué le principe de triangulation qui permet de localiser la zone exacte du séisme, Damien présente les travaux novateurs de chercheurs du laboratoire GeoAzur. Les scientifiques ont ainsi découvert un signal précurseur, une sorte d’onde de gravité qui se déplace à la vitesse de la lumière et qui permettrait de prévenir les séismes plus précisément.
« Nourris par ces grandes quantités de données, des algorithmes d’IA bien entraînés seront bientôt en mesure de reconnaître ce signal pour pouvoir faire de la préalerte » – Damien, pas physicien mais qui s’y connait vachement bien quand même…


En guise de dessert, c’est Guillaume Detandt, ingénieur d’étude, également membre de l’équipe de l’UAR IMAGO, qui prend la parole pour nous parler du projet ReefTEMPS, « un réseau qui a pour objectif de suivre l’évolution de la température marine près des récifs coralliens ». Un réseau qui existe depuis 1958 et dont la quarantaine de stations mesurent avec précision la température de l’eau, et parfois également la salinité ou la pression. Guillaume illustre ensuite ses propos avec l’exemple de la station de l’Anse Vata qui collecte des données depuis 1955 (!) et qui a ainsi observé une augmentation de 0,16 degré par décennie, soit de 1,6 degrés sur un siècle. C’est à la fois infime mais énorme pour nos amis les coraux et autres biodiversités marines.
« D’ici quelques années, l’IA sera utile pour traiter et analyser toutes ces données afin de détecter un phénomène spécifique ou une anomalie de manière automatisée et de mieux comprendre les impacts du réchauffement de l’eau sur la biodiversité » – Guillaume, deux temps, trois mouvements… en temps réel.
__
Pas de data, pas de chocolat !
Il serait sûrement un peu cavalier d’affirmer que nous en avons appris beaucoup sur l’application des technologies d’intelligence artificielle comme outil de mesure du changement climatique mais tout à fait injuste de dire qu’on n’a rien appris non plus.
En effet, ces trois scientifiques ont su partager avec pédagogie et expertise leur métier respectif et faire comprendre à l’audience du jour que « sans data, pas de chocolat ». Ou plutôt qu’avec la data, on comprend beaucoup mieux cette nature qui nous entoure. Et qui dit « comprendre », dit sans aucun doute mieux « protéger ». Et ça, c’est déjà une bonne occaz’ de faire la Fête !
__