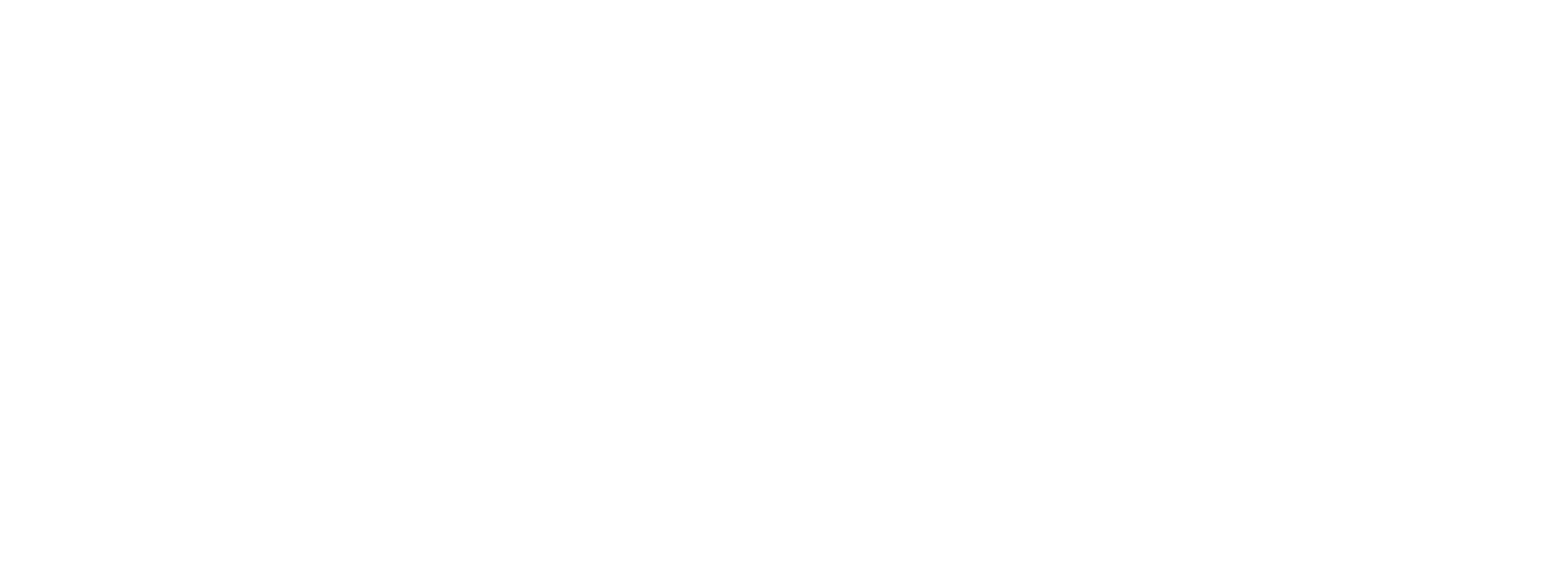Comment parler de la géopolitique du Pacifique sans mentionner le travail de la « Communauté Du Pacifique », organisation intergouvernementale basée à Nouméa ? Des recherches scientifiques sur le milieu océanique à la crise sanitaire, des objectifs de développement durable aux statistiques relatives à la gestion des ressources terrestres, la CPS se sert quotidiennement du numérique pour accompagner les gouvernements dans leurs prises de décision. NeoTech a eu le plaisir d’échanger avec son Directeur Général Adjoint, Cameron Diver.
__
Bonjour Cameron, vous êtes le Directeur Adjoint de la Communauté du Pacifique ; pourriez-vous nous raconter votre parcours professionnel ?
Je suis né en Nouvelle-Zélande et arrivé en Nouvelle-Calédonie pendant mes études supérieures ; j’ai enseigné sur le territoire comme Assistant de Langue Anglaise pendant deux ans avant d’être recruté par le service juridique du Gouvernement où j’ai pu travailler sur la mise en œuvre de la Loi Organique Statutaire juste après la signature des Accords de Nouméa : une période passionnante !
En 2005, je suis devenu le premier coordinateur de la cellule de Coopération Régionale et des Relations Extérieures du Gouvernement avec pour mission de développer et faciliter l’intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie et conseiller les autorités calédoniennes sur des problématiques de relations internationales. C’est également à cette époque que j’ai commencé à collaborer régulièrement avec la Communauté du Pacifique (CPS) car je siégeais comme représentant de la Nouvelle-Calédonie dans les organes de gouvernance de la CPS mais également au sein d’autres organisations internationales.
Par la suite, après une courte période à la Direction Juridique de la Province Sud, je suis reparti avec ma famille en Nouvelle-Zélande pour œuvrer en tant qu’avocat spécialisé dans les arbitrages internationaux avant de céder à nouveau aux sirènes de la Calédonie et de revenir sur le territoire en tant que collaborateur d’un membre du Gouvernement. Depuis octobre 2013, j’occupe le poste de Directeur Général Adjoint de la CPS.
__
Quel est la raison d’être de la CPS et quelles sont ses origines et son histoire ?
La CPS a vu le jour en 1947, juste après la seconde guerre mondiale. A l’origine, les États-membres fondateurs qu’étaient l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis ont voulu créer une organisation intergouvernementale dont la mission première était de faciliter la coopération internationale. Leur objectif prioritaire ? Améliorer le bien-être des populations du Pacifique insulaire.
Il est important de souligner que, lors de la toute première Conférence de la CPS en 1950, l’organisation a été salué comme « le parlement des peuples du Pacifique » puisque, pour la première fois, des représentants de peuples autochtones des territoires membres siégeaient à la Conférence aux côtés des Commissaires des pays métropolitains. Chose rare pour l’époque et qui reflète bien l’ADN de la CPS à travers les années : un lieu où chaque pays membre peut agir sur la scène internationale avec leur identité, leurs points de vue et leur culture et bénéficier du même droit à la parole.

Une autre illustration de cette approche inclusive a eu lieu en 1983. Après la vague de décolonisation des années 60-70, de nombreux territoires sont devenus indépendants et ont intégré la CPS. En 1983, lors de la Conférence de la CPS à Saipan, il a été décidé de donner à tous les membres de la CPS, quel que soit leur statut institutionnel – Etat souverain ou territoire -, les mêmes droits et obligations.
À la CPS, la prise de décision s’effectue à 99,9% du temps en consensus ce qui permet à chacun de faire valoir son avis et de participer pleinement à la mise en œuvre des stratégies de l’organisation.
__
Comment devient-on membre de la CPS et quelles sont les principales missions de votre organisation aujourd’hui ?
Pour être membre, il faut accéder au traité constitutif de la CPS, l’Accord de Cambera, signé par les états fondateurs en 1947. Tous les membres de la CPS versent, chaque année, une contribution statutaire qui abonde au budget de fonctionnement de la CPS et cela, proportionnellement à leurs moyens. Certains membres, dont les Etats Membres fondateurs, financent également d’autres activités et programmes de l’organisation au bénéfice des pays et territoires insulaires. Nous collaborons également avec des partenaires externes (UE, AFD, GIZ, Banque Mondiale, USAID, Fonds vert pour le climat etc…) et des bailleurs de fonds, qui apportent des financements pour renforcer notre capacité à mettre en œuvre nos programmes.
Aujourd’hui, notre objectif n’est pas d’être un « guichet unique qui fait tout pour tout le monde », mais plutôt d’être une plateforme de partenariats qui fédère la cohorte d’organisations internationales et intergouvernementales qui œuvrent dans la région. En parallèle, nous avons également nos propres missions qui correspondent, peu ou prou, aux 17 objectifs de développement durable (ODD) : changement climatique et durabilité environnementale, santé publique, géosciences terrestres et marines, qualité des systèmes éducatifs, égalité des genres, droits de la personne, statistiques et données relatives au développement, ressources terrestres (agriculture, foresteries) et marines etc… sont autant de problématiques qui sont traitées dans nos programmes.
Nous avons aussi développé un programme de classe mondiale en matière de pêche qui contribue directement à la gestion de la plus grande pêcherie de thons au monde dans le Pacifique occidental et central. Nous mettons ainsi nos expertises scientifiques, techniques ou en sciences sociales à disposition des pays, dans le cadre de programmes régionaux et nationaux pluriannuels et ce, en fonction des besoins qui sont exprimés. Notre objectif, si je vulgarise, est d’améliorer le bien-être quotidien des populations des États membres.

__
Quelles sont les applications innovantes du numérique que vous utilisez à la CPS ?
Nos équipes des programmes de pêche ont développé plusieurs applications innovantes ; je pense notamment à l’application « Ikasavea » qui permet aux pêcheurs de rentrer directement les données liées à leur pêche depuis leur bateau ou au port. Grâce à l’intelligence artificielle embarquée dans cet outil, nous sommes en mesure d’identifier le poisson pêché, sa taille réelle et de suivre ainsi l’évolution des stocks, d’augmenter la traçabilité et de mesurer l’effort de pêche, quasiment en temps réel. Quand je pense qu’à l’époque, nous recevions ces données par la poste via des papiers pliés dans des bouteilles de verre… Que de chemin parcouru grâce au numérique depuis lors !
Un autre exemple d’outil innovant : notre plateforme numérique de données océanienne (Pacific Data Hub) ; cette plateforme permet de fédérer les données de nos partenaires locaux et internationaux et de centraliser l’information statistique sur le développement durable au sens large du terme. On peut y trouver moult données sur l’océan, non seulement sur la pêche, mais également sur la santé de l’océan ou son niveau d’acidification. Mais on y trouve aussi des informations sur les progrès de chaque Membre de la CPS vers les ODD, sur l’agriculture ou sur la législation en matière d’égalité homme-femme dans les pays de la zone par exemple. Cela permet, en complément de nos autres programmes, aux États et territoires de la région d’avoir accès des éléments d’information fiables pour mieux comprendre certains enjeux et mieux accompagner les prises de décision éclairées sur divers sujets.
De plus, nous sommes en train de développer un projet de plateforme, le « Digital Earth Pacific », qui va permettre de consolider, au niveau de la région, une masse extraordinaire de données d’observation de la Terre. Ces données, issues du réseau satellitaire ou des télédétections, nous offriront, par exemple, la possibilité de suivre en temps réel la couverture végétale, la température de l’eau (etc.) et de concevoir des outils d’aide à la décision pour les pouvoirs publics et les acteurs économiques. Rien de tel n’existe actuellement à l’échelle de l’Océanie ! En organisant un accès public à la donnée, on lui confère encore plus de valeur et d’utilité.
Last but not least, nous travaillons également sur le domaine de l’informatique à haut rendement. Nous utilisons un « supercalculateur » en collaboration avec des plateformes en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il permet d’effectuer des analyses statistiques ou scientifiques lourdes beaucoup plus rapidement. Pour ce faire, nous avons dû augmenter notre bande passante de 800% ! C’est une avancée majeure dans le traitement des données et leur analyse complexe.
__
La « data », sous différentes formes, est capitale pour la recherche scientifique. Quels sont les domaines qui sont les plus concernés par cet « or numérique » et comment exploitez-vous ces données ?
Actuellement, pour des raisons conjoncturelles, ce sont les données de santé qui captent notre attention : on ne peut trouver une réponse pertinente à la crise sanitaire de la COVID sans l’utilisation des données, qu’elles soient internationales ou locales. Flux de passagers, nombre de personnes qui entrent et sortent d’un pays, capacité d’accueil dans les hôpitaux, nombre de lits en réanimation, doses de vaccins, populations sensibles ou qui souhaitent être vaccinées (…) sont autant d’informations capitales pour prendre des décisions mesurées, basées sur l’analyse des risques.
Au niveau de la pêche, la data est capitale à la fois dans le domaine de la pêcherie halieutique, – globalement celle du thon – mais également de la pêcherie côtière, plus locale. Cette dernière est malheureusement, dans certaines zones, en proie à la corruption et à des abus mais on peut en limiter les effets grâce à nos connaissances statistiques. Ces données permettent donc à chaque pays d’adapter leur politique en matière de pêche en disposant d’arguments concrets, basés sur la science, pour limiter la pression sur l’environnement et assurer l’exploitation durable de la ressource.
Ces multitudes de données permettent aussi de connaître l’impact des changements climatiques à l’échelle de la Terre mais aussi les incidences des changements océaniques sur les zones côtières par exemple. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que chaque indicateur de développement durable est interdépendant : la donnée permet d’obtenir une vision globale de l’état des écosystèmes ou des sociétés à un moment T et donc de prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause.

__
La surpêche est une problématique géopolitique et environnementale capitale pour la zone du Pacifique. Où en est-on aujourd’hui à ce niveau et en quoi le numérique peut-il représenter une solution pour réduire la pression sur l’océan Pacifique ?
En fait, en Océanie, nous avons la chance d’avoir une pêcherie très bien gérée. Ok, il y a encore de la pêche illicite dans la ZEE ou ailleurs mais la pêcherie au thon est en bonne santé. Le suivi que nous effectuons sur les stocks nous permet de savoir que nous ne sommes pas en « surpêche » dans la région. Même si les débats entre les États sont parfois houleux tant les intérêts économiques sont grands, la zone océanienne est bien armée pour la gestion durable de cet écosystème en particulier.
Le danger viendra lorsque les stocks de poisson vont bouger d’ouest en est sous l’effet du réchauffement climatique. Aujourd’hui, la plus grande concentration de thons se trouve dans le Pacifique central et occidental mais, demain, elle se déplacera plus à l’est, dans des zones de haute mer, où la liberté de pêche est plus large, d’où l’importance des négociations actuelles sur la préservation de la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Notre rôle est de faire en sorte que cette ressource économique et alimentaire soit préservée de manière durable.
Le numérique permet donc d’obtenir des informations capitales sur l’effort de pêche et la pression sur l’océan, mais également de mieux surveiller cette activité, notamment grâce aux technologies satellitaires ; on est dans une période où le numérique a un rôle capital à jouer à la fois dans la sécurisation de la pêche mais aussi dans l’approfondissement des connaissances sur nos ressources et leur état.
__
Plus globalement, quelle est votre vision de la transformation numérique du territoire et quel modèle économique pourrait lui permettre de faire la transition avec la réduction des ressources en nickel ?
Il ne m’appartient pas de m’exprimer sur les choix politiques faits en Nouvelle-Calédonie ; néanmoins, ce qui est certain, c’est qu’il existe une opportunité énorme en termes de transition numérique et écologique.
A propos du numérique, on pourrait imaginer jouer avec le décalage horaire avec l’Europe pour mettre en place des systèmes de « journées continues » pour certaines entreprises. D’autre part, l’industrie du numérique permet de créer des emplois locaux au service d’autres parties du monde par exemple… Le numérique peut permettre également d’optimiser d’autres secteurs tels que l’agriculture, le maraichage, l’arrosage des cultures ou l’éducation et la formation…
Concernant la ressource nickel, il s’agit d’une ressource non renouvelable et dont le bénéfice pour l’économie est limité en fonction de l’épuisement des réserves ; c’est donc aujourd’hui qu’il faut penser à l’avenir pour combler ce manque futur. Sur un territoire comme la Calédonie, qui dispose de ressources naturelles dans son sol mais également dans la mer, ainsi qu’un niveau important de formation et d’infrastructures, on peut envisager de créer de nouvelles filières structurantes, d’investir dans les technologies vertes ou l’économie de la mer : je crois que la Nouvelle-Calédonie peut être l’exemple d’un territoire hautement industrialisé capable d’une transition écologique qui serait économiquement viable.
C’est le rôle d’une économie bleue ou verte qui mise sur la durabilité et des cycles vertueux « d’exploitation – régénération » des ressources. Ce n’est pas une utopie et c’est, à mon sens, une vraie opportunité à saisir pour répondre à « l’après nickel » .
__
Le développement durable est un sujet crucial en Nouvelle-Calédonie mais on en parle souvent pour ne citer que les « mauvaises nouvelles ». Pour une fois, avez-vous de bonnes nouvelles à nous partager concernant la situation écologique de la NC ?
L’état des stocks de thons dans la ZEE est très positif ! Si on l’exploite de manière raisonnée et durable, cette pêche continuera d’apporter de la nourriture et des ressources financières pour des années à venir.
Au niveau plus local, on voit naître des fermes « agro-écologiques » qui changent les paradigmes de l’agriculture moderne : procédés d’agriculture biologique mais aussi l’utilisations plus optimale des espaces pour maintenir la fertilité des sols, augmenter la qualité des produits finaux… La CPS est fière d’accompagner ces initiatives à travers son programme « PROTEGE« , financé par l’UE.
De bonnes nouvelles viennent également de la gestion des bassins versants : on progresse dans le domaine des captages d’eau ou dans la réhabilitation des zones dégradées grâce à des collaborations fructueuses entre les différentes institutions publiques, associatives et privées.
Je crois que le point le plus positif à ce sujet réside dans ce que je constate comme une prise de conscience globale au niveau de la Calédonie mais aussi à l’échelle mondiale : sans cette prise de conscience, on ne peut pas réellement agir ! On se rend de plus en plus compte aujourd’hui que les modèles industriel et écologique peuvent être conciliés, que ce soit au niveau de la population mais aussi au niveau des pouvoirs publics. On peut, pour donner un exemple dans le contexte local, imaginer le développement d’une politique de transition écologique à la hauteur de la politique nickel pour organiser la conjugaison de ces deux modèles économiques et l’émergence d’un futur nouveau modèle. Il faut être optimiste lorsqu’il existe des opportunités de cette nature : à nous tous, ensemble, de les saisir !